Ce chapitre traite la question de l’expansion des Baluba en Afrique
EN DIRECTION DE LA MER DU NORD
Autrefois, l’empire des Baluba, porté dans ses ambitions politiques par des grands monarques conquérants, imposa sa domination sur un vaste territoire qui allait du lac Tanganika au Kwango, sur plus de 1500 km[1] !
La première poussée est assurément celle ayant conduit les Baluba jusqu’à la mer du Nord de l’Afrique. Se référant à la légende que Mwamba, grand chef des Babemba, rapporta (en 1892) à deux missionnaires du Nyassa, Père Colle écrit :
« D’après ce vieux chef d’une grande famille, le peuple tout entier des Baluba s’est porté vers la mer, à une époque indéterminée, puis une partie est revenue en arrière, se fixant définitivement dans l’Ubemba. (…) Les familles issues de Múlúba, c’est-à-dire les Baluba dont parle Mwamba, se seraient dirigés vers le Nord ou le Nord-Ouest. A leur retour, ils se seraient établis à l’Ouest des Baluba restés au pays et les auraient tous considérés comme descendants du Mufemba. (…) Tout cela tend à prouver.
Que le pays primitif des Baluba est situé à l’Ouest, loin de leur pays actuel.
Qu’une première poussée s’est faite vers les lagunes du Kamelondo.
Qu’une poussée s’est faite en même temps, ou plus tard vers le Nord ou le Nord-Ouest jusqu’à la mer.
Que tout le monde est revenu sur ses pas sauf quelques groupes qui sont restés en route.
Qu’un groupe nombreux, dirigé par Kitimukulu, est allé s’établir en Ubemba, d’où il a donné naissance aux groupes Babemba et Batabwa établis depuis le Nyassa jusqu’au Tanganika.
Que les Baluba restés aux lagunes ont pris l’habitude de désigner sous le nom de Bahemba leurs frères établis à l’Est. Suivons les pérégrinations de nos Baluba, devenus Babemba[2] ».
Comme on le voit, Colle fait reculer encore plus loin dans l’histoire l’antériorité des Baluba, peut-être de milliers d’années avant Jésus-Christ, en soutenant que les Européens et les Baluba vivaient ensemble (à une date difficile à fixer) dans le Buluba (Uruwa) autour d’un père. Et que les Baluba blancs, si tant est qu’ils existaient réellement, se fixèrent en Europe dans une migration ultime. Quant à leurs frères noirs, arrivés au bord de la mer, pris de peur, ils ne purent la traverser. C’est dans ces entre-faits que le fils de Kitimukulu mourut[3]. Alors s’amorça le mouvement de retour vers le Sud, jusqu’à la mère patrie.
Sur le chemin de retour vers le pays premier, entre la Méditerranée et le Katanga, bien des peuples issus de ces migrations sont restés en cours de route créant des nouveaux foyers culturels autour des nouvelles nations et des tribus spécifiques. Ceux qui ont dépassé la partie australe de l’actuelle province du Katanga ont poursuivi leur voyage en direction du grand Sud. D’eux sont nés les Babemba, les Bashona, les Moravi, les Rozui, les Bacewa, les Ndebele, les Bazulu[4]…
Mais au-delà de l’Egypte, les fouilles archéologiques attestent également l’étroite relation entre les Baluba, l’Europe antique et le Proche Orient. Cette séquence historique nous est connue grâce aux travaux de Gilbert Mbangu a Mukkand qui nous renseigne que :
« La découverte en 1887 aux environs de Bukama, par 50 centimètres de profondeur dans le sol, d’une petite statuette du Dieu égyptien Osiris intrigua fort les spécialistes. Soumis à l’égyptologue belge Capart, son analyse autorisa à penser que des caravanes partant de cette région avaient établi au loin depuis des siècles des contacts avec des marchands phéniciens, Grecs, Egyptiens et Arabes. Le précieux objet datait d’environ 2300 ans avant Jésus-Christ[5] ».
A ce même sujet, Ndua Solol quant à lui nuance quelque peu au sujet de ces liens entre la statuette et le peuple Muluba actuel :
« Certes, et on a raison de le répéter, une civilisation exhumée en un lieu donné n’a pas nécessairement un lien avec les populations qui occupent actuellement cet endroit[6] ».
Comme les Baluba existaient physiquement dans cette contrée bien des siècles avant la naissance de Jésus-Christ, et même à l’époque où les ancêtres des Blancs et des Noirs vivaient encore en Afrique centrale, c’est donc eux qui avaient noué des contacts avec les peuples du Nord de l’Afrique et du Proche-Orient !
Sur ce point, Gilbert Mbangu est, nous semble-t-il, en accord avec notre avis :
« L’existence du commerce est confirmée par la découverte de cauris et de perles de verre et surtout, la création d’une véritable monnaie : à savoir les croisettes de cuivre, retrouvées même sur les lointains rivages de l’Atlantique et de l’Océan Indien[7] ».
Il y a donc lieu d’admettre que du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, toute l’Afrique était en contact avec les Baluba.
EN DIRECTION DU NORD-OUEST
LES BALUBA DU SUD KATANGA ET DU NORD DE LA ZAMBIE
Au sujet de cette catégorie des peuples bantu Cornevin déclare :
« Toute une série des peuples du Sud Katanga et de la Rhodésie du Nord se réclament d’une origine louba, les Bemba, Lamba, Lala au Congo, les Ounga, Lamba, Kaonde en Rhodésie sont les plus importants. La langue kilouba est l’une des quatre grandes langues véhiculaires du Congo. Elle est employée pour l’enseignement primaire dans les provinces du Katanga et du Kasaï[8] ».
Dans le même ordre, Jan Vansina affirme :
« Les Kaonde disent qu’à l’origine, ils étaient des Lubas provenant du Nord et ils parlent Luba[9] ». Pour E.Verhulpen, «selon certaines traditions, les Basanga et les Banweshi seraient apparentés aux Bakaonde et aux Balamba. Après avoir constitué jadis un seul et unique groupe ethnique parlant une langue luba, ils se seraient divisés pour former des Basanga (Chef Pande), des Bakaonde (Chef Kaindu), des Balamba (Chef Kifongo) et des Banweshi (Chef Sampwe[10]).
Quant à Banza Mwepu Mulundwe, qui a consacré une recherche intéressante à cette question, il signale les faits suivants :
« Les Cewa de Zambie (…) se réclament d’ancêtres Baluba.
Les Bemba du Nord-Est de la Zambie prétendent eux-mêmes qu’ils descendent du Múlúba Kichi-Mukulu (…).
Comme les Babemba, les Basanga se disent descendre du Múlúba Mutombo Kola (…).
Les Kaonde de la vallée du Zambèze, proches parents des Basanga et des Babemba, affirment eux aussi descendre des Baluba dont, plus que tous les autres, ils conservent plus fidèlement la langue et la conscience de leur origine commune[11] ».
LES BALUBA DE LA ZAMBIE, DE LA TANZANIE, DU MALAWI, DU ZIMBABWE, DU MOZAMBIQUE, DE L’AFRIQUE DU SUD…
Le deuxième mouvement d’expansion des Baluba est celui qui s’est naturellement porté vers le Sud. Certains savants, comme Thomas Reefe, situent la séparation entre les langues Kibemba et Kiluba en reculant la généricité pratiquement à l’ère chrétienne. Ce qui attise davantage le débat autour de la séparation des peuples d’origine Múlúba :
«Linguists and historians have examined the languages of the savanna and using lexicostatistical analysis, have suggested the relative chronological distance at which some of them diverged from on another. The percentages of correlations in vocabulary between langagues of the luba-bemba cluster suggest that the parent languages of the luba of shaba and the bemba diverged some 2000 years ago. Thelanguage of the luba kasai diverged from that of the luba of shaba some 1200 years ago. While hemba separated as recently as 500 years ago[12]»:
On peut inférer ici que les Babemba étaient au départ des Baluba qui parlaient Kiluba, avant la naissance de Jésus-Christ ! Ces indications semblent corroborer les investigations de Père Colle, en rapport avec les pérégrinations des Baluba devenus in fine Babemba !
Mais au-delà de Babemba, selon Banza Mwepu Mulundwe, la filiation des Baluba dans leurs expansions australes a donné naissance à bien d’autres peuples de cette région qui continuent à se revendiquer l’origine Múlúba. Tels que :
« 6. Les Rozui (Lozi) du Zimbabwe, près de Stanley Falls, sont d’origine Luba-Lunda.
7. Les Shona (Bakalanga : Vakaranga) du Zimbabwe, parents des Baluba, donc, comme eux, originaires de l’Ouest du lac Tanganika, et des rives du lac Kisale, occupèrent la région allant du Zambèze au Limpopo et du Kalahari, à l’Océan Indien, vers le XVe siècle. On leur doit les merveilleuses 350 ruines de Zimbabwe (Nzibo ya mabwe, palais ou grande maison de pierres en kiluba[13]), (…) ».
C’est en lisant J. Vansina qu’il est donné de rapprocher davantage une telle proximité généalogique :
« Les peuples du plateau rhodésien étaient organisés en petites chefferies, exactement comme dans la partie supérieure de la vallée du Luapula. Leurs chefs étaient sans doute d’origine Luba ou Hemba, et portaient le titre de Mulopwe wa bantu, chef du peuple, Mulopwe signifiant évidemment chef dans la langue Luba. Ceci s’accorde parfaitement avec les traditions des peuples Cewa et Maravi vivant plus au sud-est, qui se disent originaires eux aussi du pays Luba[14]
«.Notons ici que si en Kiluba, les lettres v et b, r et l permutent librement, cependant le sens demeure le même. C’est le lieu de préciser qui plus est que : « Les Shona (Bakalanga : Vakaranga) du Zimbabwe sont parents des Baluba Bakalanga dans le district du Tanganika d’où ils sont originaires ».
Le terme kiluba « Ngoni », oiseaux, est le nom par lequel les Bazulu de l’Afrique du Sud s’identifient. L’expression « Ngoni ya madjulu » ou « Ngoni a mazulu » signifie les « oiseaux (descendus) du ciel ».
Evoquant les mêmes « peuples dérivés » du buluba et leurs symboliques sous-jacentes, l’auteur précité indique : « A la fin du XVIIIe siècle, les Ngoni (Ngoni ya madyulu : oiseaux fils du ciel : Ngoni a Mazulu), avec à leur tête l’intrépide Chaka, passèrent le Limpopo et se lancèrent à l’assaut de la pointe sud du continent africain. (…) Les Ngoni (Zulu) du Natal, descendants des Shona du Zimbabwe, originaires de la vallée du Congo, s’apparentent donc eux aussi aux Baluba[15] ».
Il s’agit en l’occurrence des Maravi, des Rozui, des Babemba, des Wasenga, des Nyanja, des Aushi, des Lala, des Ambo, des Luano, des Lamba, des Balemba, des Basisi, des Bakaonde, des Balima… Jusque chez les Ndebele, les Ngoni a Mazulu ou Zulu…, la culture des Baluba a marqué de son empreinte la vie de ces peuples sud-africains.
En nous référant aux indications chronologiques fournies par certains chercheurs, il apparaît clairement que l’origine kiluba des Babemba, elle non plus, n’est pas à mettre en doute. Voici la précision qu’en fournit Jan Vansina :
« La première immigration semble avoir été celle des Bemba. Les quelques indications chronologiques dont nous disposons semblent situer leur sortie du pays Lunda au cours du règne de Cibinda Ilunga dont ils étaient des suivants Luba. Ceci explique pourquoi les chercheurs qui étudient la tradition des Bemba se sont toujours opposés au sujet de l’origine de ce peuple, les uns prétendant qu’il est d’origine Lunda, les autres lui attribuant une origine Luba. La meilleure source Bemba connue à ce jour, le panégyrique de Nkole wa Mapembwe, second roi ou Citimukulu, manifeste son accord avec la tradition citée lorsqu’il dit : « Nkole wa Mapembwe…tu étends le pays Lunda. Tu es un vrai chef Luba[16] ».
Un autre éclaircissement s’impose ici : l’émigration des Baluba, devenus par la suite des Babemba, est assurément antérieure à la formation des Empires. Ce, en nous fondant sur la dation des historiens, en l’occurrence ceux qui remontent la séparation entre le Kiluba et le Kibemba à plus de deux mille ans[17].
Toujours est-il que, de nos jours encore, lorsqu’un Múlúba locuteur du kiluba arrive à la cour royale de Kiti Mukulu en Zambie, autorité qui se reconnaît de la descendance de l’ancêtre originel Nshi Mikulu, il y est accueilli en tant que fils du pays.
EN DIRECTION DU NORD-EST :
LES BALUBA DE LA PROVINCE ORIENTALE
Les migrations du Nord du pays, jusqu’à la ligne de l’Equateur, nous conduisent à présent sur les traces des Wagenia. Cet épisode nous est ici rapporté avec de précieux détails sous la plume de Crine-Mavar:
« A une époque très ancienne, les ancêtres des pêcheurs Wagenia, originaires de la contrée lacustre du Shaba (Katanga) central, descendirent le Lualaba jusqu’au-delà de Kongolo et occupèrent toutes les îles du fleuve. Le calcul lexico statistique attribue une profondeur de 740 années à la séparation intervenue entre wagenia (Baenya) de Kisangani et Wagenia du Shaba (Katanga). Ce qui nous reporterait à 1230. Une date qui prend valeur d’un possible, parce que justement coincée entre 800 (installation d’un fond de population pré-luba Shankadi) et 1450 (avènement de l’empire des Baluba shankadi[18]) ».
Le même auteur ajoute plus loin :
« A une époque contemporaine des premières tentatives d’organisation de l’empire des Baluba Shankadi, des pêcheurs originaires de la contrée lacustre du Shaba (Katanga) central descendirent encore le Lualaba et se disséminèrent le long des rives et sur les îles du fleuve, depuis Bukama jusqu’au-delà du 5ème parallèle nord. Ces pêcheurs connus sous l’appellation générique de Wagenia descendent de l’ancêtre Kikulu Manda (…). Quelque fois, on les désigne du nom de Balaba (dérivé de Lualaba) ou encore du nom de Waluba-Wagenia. Leur économie, presque exclusivement axée sur la pêche, les poussa depuis des temps immémoriaux à entretenir des relations avec des populations riveraines, chez lesquelles ils écoulaient ou échangeaient les produits de leur pêche[19] ».
Et l’on peut le vérifier aujourd’hui encore : les Baluba de Bukama, de Malemba, de Ankoro …, du moins ceux qui résident dans les abords du Fleuve Lwalaba (Congo), sont appelés Balaba, Baluba de Lwalaba. De même, les Wagenia s’identifient aux Baluba de la Province orientale. Faisons remarquer que s’ils s’appelent Waluba Wagenia jusqu’en province Orientale, c’est que le terme waluba (Baluba) est anterieur à 1230 après Jésus-Christ.
[1] Banza Mwepu, Le mythe des origines des Baluba, Dikasa, Lubumbashi, 2001, p. 72.
[2] R. P. Colle, op. cit., pp. 47-49.
[3] Idem, p.46. Texte recueilli au Nyassaland par deux missionnaires blancs auprès du Chef Mwamba, d’origine Múlúba.
[4] Ibidem.
[5] Banque du Congo Belge 1909-1959, éd. L ; Cuypers-Bruxelles, cité par Gilbert Mbangu a Mukkand, Le Katanga et son destin, éd. Gmb investa, Lubumbashi, 1995, p.1.
[6] Ndua Solol, op.cit. p.130
[7] Mbangu a Mukkand Gilbert, ibidem
[8] Cornevin, R., L’histoire du Congo, Paris, Berger-Levrouet, 3ème éd., 1970, p.47
[9] Vansina Jan, Les anciens royaumes de la savane, Léopoldville, IRES, 1965, p.127.
[10] E. Verhulpen, op.cit. p.394.
[11] Banza Mulundwe, Le mythe des origines des Baluba, éd. Dikasa, Lubumbashi,
2001, pp. 35-38.
[12] T. Reefe, The Rainbow and Kings. A history of luba empire, to 1891, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, London, England, USA, 1981, p.74.
[13] Banza Mulundwe, op. cit. pp. 35-38.
[14] J. Vansina, op. cit., p. 68.
[15] Banza Mulundwe Ibidem, p. 38
[16] J., Vansina, op. cit., p. 68
[17] Reefe Thomas, The Rainbow and Kings. A history of Luba empire to 1891, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, London, England, USA, 1981, p.74.
[18] Crine-Mavar, op. cit., pp. 23. 59.
[19] Ibidem.

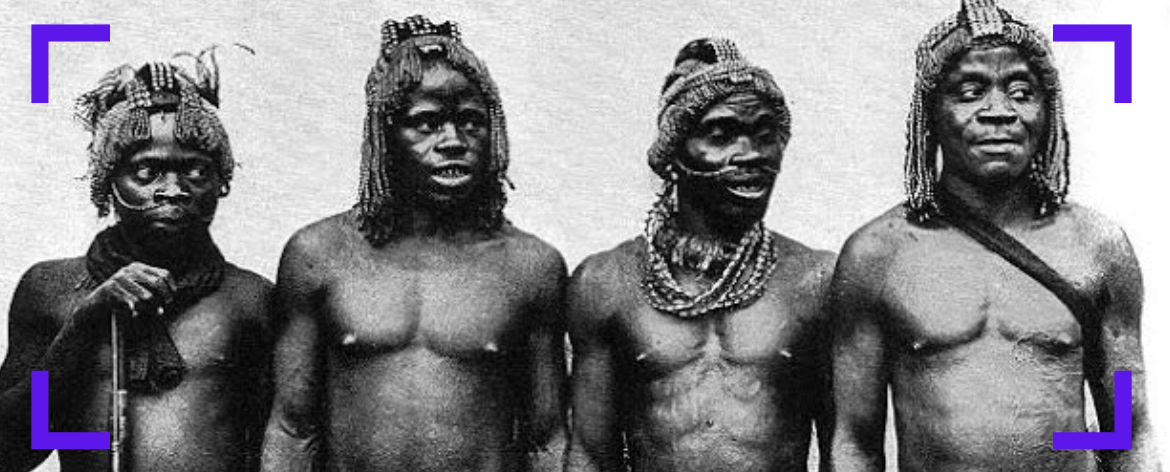
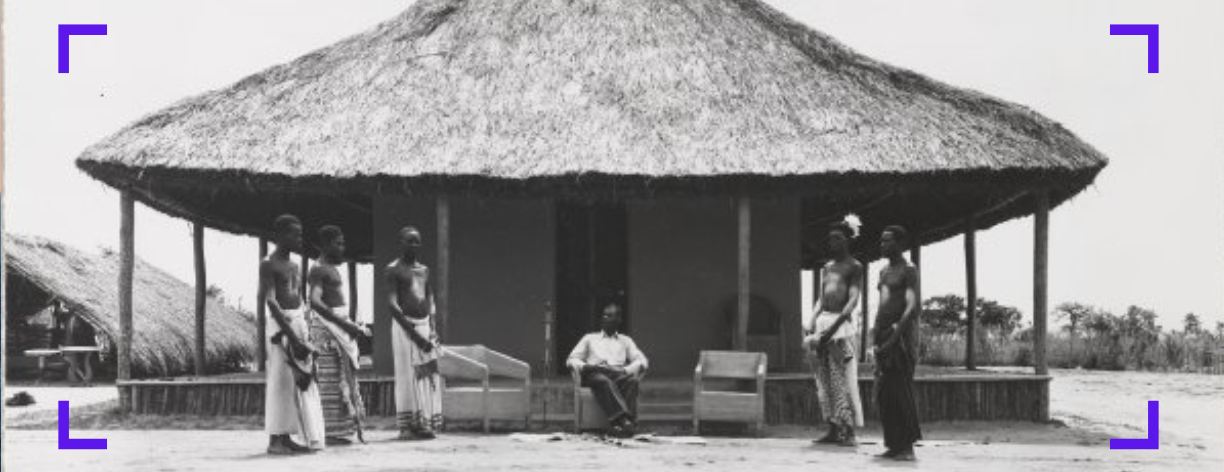

Commentaires