Avant l’implantation des Basonge entre le Maniema, le Sankuru et le Katanga actuel, toute cette contrée parlait kiluba. Les Baluba occupaient un territoire qui s’étendait jusqu’au Maniema. De la sorte, comme nous renseigne Verhulpen :
« Les Bena Kalebwe ou Bekalebwe, Basonge du Lomami, ont vu sur le sol à leur arrivée, les Bena Kibeshi ou Bena Eki, Basonge venus avant eux dans le pays et ayant rencontré les Bena Musolo (gens de Kapepula) et les Bena Nsamba, parlant Kiluba. Les Bena Kibeshi auraient déjà parlé à cette époque une langue Basonge, influencée par le Kiluba[1] ».
Autant dire que toute la population des Basonge occupant la contrée située au-delà de l’actuelle ville de Kabinda, jusqu’à la frontière des Batetela, parlait kiluba. A l’aube de l’implantation de l’empire, le Buluba (Uruwa), selon Verhulpen, touchait jusqu’aux peuples du Maniema, cela par le biais des campagnes militaires : « Il (Ilunga Kalala) trouva moyen d’assujettir jusqu’aux lointaines régions du Kalebwe et du Songi et d’y implanter la légende de sa renommée[2] (…) ».
Kalala Ilunga avait, on le voit bien ici, atteint le Maniema avec ses conquêtes armées et assujetti les peuples de cette contrée à l’empire kiluba.
Nous connaissons cet épisode à travers les travaux du même Crine Mavar :
« Poussant toujours plus avant vers le nord, les envahisseurs Baluba Shakandi désormais placés sous le commandement de Buki pénétrèrent dans la seigneurie basonge : Bena Kiloshi, comprise dans le quadrilatère formé par Katea, Kongolo, le Mont Sampwe et Kitule. Ils séjournèrent massivement dans cette seigneurie qui resta l’un de leurs postes avancés. Ils y nouèrent d’abord des alliances avec leurs hôtes, ainsi qu’avec les Bena Wangongwe, les Bena Kumbi et les Bena Kayayi, en vue d’étendre leur domination sur les tribus de la civilisation du triangle nord-est[3] ».
Comme pour appuyer cette analyse historique, Vansina déclare :
« Dans les années 1860, Tippu Tib entendit dire de lui : « Jadis, nous avons entendu dire par nos aînés que le chef suprême d’Urua, nommé Kumwimba (Kumambe) et par après Ilunga Kabale (Rungu Kabare) régna sur tout le pays Urua jusqu’à Mtoa (sur le Lac Tanganika) y compris le pays Manyema (Maniema méridional) et les rives de la rivière Lomami (Rumani). Il avait entrepris de mener la guerre sur toute cette région et il atteignit Utetela (Kusu sud- oriental)[4] … ».
Et plus loin, il ajoute :
« A l’époque où Rungu Kabare était chef, il était le plus puissant des chefs Warua et leur souverain. Il avait mené la guerre dans toutes les régions du Maniema. Seul le Lac Tanganika l’arrêta[5] ».
C’est à la lumière de tels témoignages qu’il est permis de soutenir que les Bahemba du Maniema sont une branche des Baluba (leurs chefs étant des Warua = Baluba). De la sorte, ils autorisent d’être classés dans l’aire culturelle Kiluba. On en retrouve les affinités jusque dans le domaine des arts, dans lequel ils respectent à merveille les canons de l’art kiluba.
Il suffit ici de relire William Fagg pour s’en convaincre :
« On les (masques de bois représentant un chimpanzé) trouve parmi les groupes niembo et mambwe des Hemba qui, bien que parlant leur propre dialecte bantu, le Kihemba, sont ici traités pour la classification artistique comme partie intégrante du grand complexe luba. En art, les Hemba sont les plus luba des luba[6] ».
Quoi de plus normal quand on sait, comme l’indique T. Reefe,que « le Kihemba se sépara du Kiluba récemment, il y a de cela seulement 500 ans[7].
On peut en dire autant des Songi, Wasongola, Aluba, Wazula, Wazimba, Bangubangu, Bahemba… Tous ces peuples du Maniema ont connu l’empreinte de la langue et de la culture des Waruwa (Baluba).
Comme cela apparaît à travers ce développement, le Maniema est une région habitée par les peuples issus de trois grands ensembles ethniques, à savoir : les Baluba au Sud, les Anamongo à l’Ouest et les Balega au Nord[8].
A noter que les Baluba résident principalement dans les Territoires de Kabambare et de Kasongo ainsi que dans une partie du Territoire de Kibombo. Ils y partagent la terre avec les Bakusu, branche des Anamongo venus de la région des Batetela (Sankuru) qu’ils croisèrent à la faveur d’un mouvement migratoire opéré en direction du Sud.
Est-il que la plus importante invasion des Baluba au Maniema a lieu à l’époque de Mulopwe Kasongo dit Mwine Kibanza, successeur d’Ilunga Kalala, deuxième Mulopwe des Baluba, ayant régné vraisemblablement au XIIIe siècle de notre ère.
Poussé par l’aventure et par l’esprit des conquêtes vers le Nord, à la suite d’une importante campagne militaire, Kabango, le fils du souverain Kasongo, réussit à conquérir par la force le pays qui s’étend aujourd’hui du Territoire de Kongolo jusqu’à la frontière des Balega de Pangi. Arrivé en pays Balega, il se présenta comme prince, fils du souverain des Baluba, et revendiqua la souveraineté Múlúba sur toute la forêt vierge qu’il venait de traverser !
A cette même occasion, séduite par la beauté, la noblesse, l’élégance et la corpulence du prince étranger, la princesse Lega en tomba amoureuse. Elle finit par l’épouser, ce après une grossesse que les deux amants ne pouvaient plus autrement dissimuler ! De l’union entre un fils des Baluba Sinda (=ceux qui ont perdu le chemin) et la Princesse Lega naquirent cinq fils. Que l’on considère aujourd’hui comme les ancêtres des actuels Bangobango[9] : Bahombo, Bahemba[10], Lulindi, Kanyengele, Ngunda.
Quant aux membres de la communauté de Kabango, ils ne rentrèrent plus dans le pays des Baluba. Ayant opté de résider dans le Maniema, ils y prirent femmes.
De là, l’émergence des tribus Babuyu, Aluba (Baluba), Wazula, Kasenga. Wazimba résidant dans le territoire de Kasongo y ont pour frères de même souche les Nonda, (fils d’un frère de Kabango dont le nom est perdu). Les Aluba sont une branche des Baluba qui avaient traversé le fleuve pour s’implanter dans le territoire des Bakusu tandis qu’une autre branche poursuivra la descente avec le fleuve. Ce sont les Wagenia de la province orientale. Ce qui permet de dater ces migrations, autour de 1230 après Jésus-Christ.
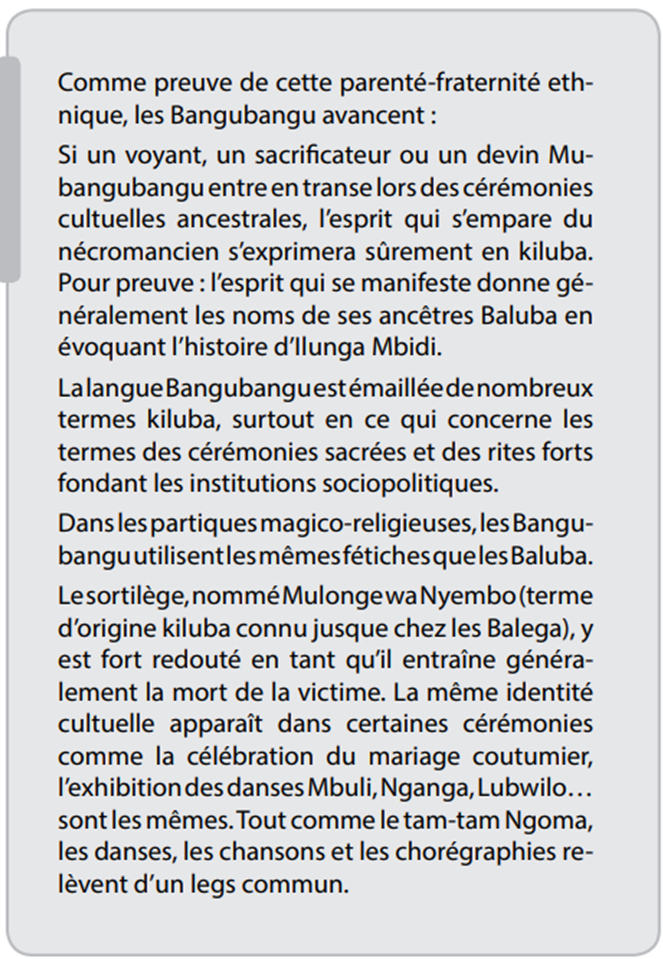
LES BALUBA DU LOMAMI
Précisons ici que le kiluba pur se parlait aussi au-delà de la cité actuelle de Kabinda, voire à Mpanya Mutombo et au-delà, à la frontière directe avec les Batetela[1]. De l’avis de Kabamba Nkamany :
« Jusqu’ici personne n’a réussi à situer l’origine exacte des Songye. Leurs légendes les plus récentes les apparentent à la tribu « Bakalanga » du Maniema et décrivent leur berceau comme étant un Pays brillant (probablement à cause des richesses minérales) et dont le climat est doux[2] »
Toutefois, après avoir signalé qu’il n’était pas aisé de déterminer avec exactitude l’origine du peuple Musonge, le même auteur se veut rassurant lorsqu’il ajoute le complément d’information que voici :
« Le peuple Songye d’aujourd’hui fait partie intégrante du peuple zaïrois. Un grand groupe est reparti de l’actuel Zimbabwe en passant par Nsanga a Lubangu, en transitant par l’Empire des Baluba Shankadi pour enfin s’installer aux emplacements actuels, lors des mouvements migratoires du XVIIe siècle[3] ».
Il s’agit-là, de notre point de vue, d’une affirmation contestable. En effet, lors de nos recherches sur terrain en 2001, au Zimbabwe, sur la parenté entre les Baluba et les Bashona, il nous est apparu clairement exprimé dans les propos de ceux-ci, que leurs ancêtres à eux provenaient de l’Afrique centrale, du pays des Baluba locuteurs du kiluba.
Autant qu’il nous souvienne, avec Banza Mulundwe, il nous a été donné de voir précédemment que :
« Les Shona (Bakalanga : Vakaranga) du Zimbabwe, parents des Baluba, donc, comme eux, originaires de l’Ouest du lac Tanganika, et des rives du lac Kisale, occupèrent la région allant du Zambèze au Limpopo et du Kalahari à l’Océan Indien vers le XVe siècle. On leur doit les merveilleuses 350 ruines de Zimbabwe (Nzibo ya Mabwe : Palais ou grande maison de pierre en Kiluba), d’inspiration architecturale nubienne et d’origine nègre suméro-égyptienne comme les Bantu euxmêmes, leurs auteurs[4] ».
Il est permis d’inférer avec le Révérend Père Samain que les Basonge, dans leur ensemble, sont d’origine Muluba, dans la mesure où ils « proviennent des Baluba du Lomami, des environs du lac Samba, entre Kabongo et Kamina, de sorte qu’on les considère comme un rameau des Baluba[5] ». Evidemment, par Baluba du Sud, il convient d’entendre les locuteurs du Kiluba.
LES BALUBA DU TRIANGLE NORD-EST
Sous ce segment de notre étude, une précision s’impose d’emblée : Waruwa et Baluba désignent un même mot qui, variance linguistique oblige, a subi l’interchangement libre des consonnes b et w, r et l[6].
C’est faute de saisir les choses à cette aune que Delhaise (en 1908) et Ndaywel (1996), évoquant les peuples Bakunda, Balumbu, Baboyo…, ont pu les disqualifier de leur appartenance au Buluba.
Le premier écrit :
« On les (Waruwa) appelle à tort Baluba ; ils n’ont rien de commun avec cette tribu[7] ».
Et le second de renchérir :
« Les meilleurs spécialistes de la région disent que les Kunda avec un certain nombre d’autres peuplades – Boyo, Lumbu, Kalanga, Tumbwe, etc. – sont des habitants du Buhemba mais distincts des Luba-Hemba. On entend par-là des populations du Buhemba subordonnées à l’empire luba en ce sens qu’elles se réclament de son histoire. Ces hemba méridionaux qualifiés dans le langage de Verhulpen de «Lubaïsés» pratiquent la filiation matrilinéaire du moins dans la succession cheffale; ils se démarquent des Lubas proprement dits qui sont patrilinéaires.
Le terme résiduel des hemba purs regroupe donc tous les septentrionaux qui ne se réclament pas de l’empire Luba et qui, en réalité, sont des non-Luba. Il y a donc lieu de conclure que le récit de l’arrivée du chasseur (Mbidi Kiluwe) symbolise une intervention extra-luba, en l’occurrence hemba. Celle-ci obéissant à un tout autre principe politique émanant du pays de l’entre Lwalaba-Tanganika[8] ».
Plus loin en notes infrapaginales, Ndaywel signale que dans les écrits les plus anciens ces populations sont qualifiées également d’Aruwa (Waruwa).
Or, Aruwa n’est rien d’autre que Baluba, selon le principe de la variance libre des consonnes et des voyelles ci-haut évoquée par nous. Position que nous partageons avec Père Colle qui, lui aussi, évoquant Buluba (Uruwa) affirme que ces mêmes indigènes « appellent la contrée qu’ils habitent : Buluba[9] ».
C’est de cette sorte que Tippo Tipo a pu soutenir[10] que l’empereur Ilunga Kabale (Rungu Kabare) régnait sur le Uruwa (Buluba) et qu’il était le chef suprême des Waruwa (Baluba). Si les Bakunda sont des Waruwa, c’est qu’ils sont authentiquement Baluba. Ils le sont restés jusqu’avant l’avènement de l’empire. Preuve une fois de plus que le Buluba est antérieure à l’avènement de l’empire en tant qu’organisation politique générique.
Pour corroborer cette réalité, trois proverbes Kisonge nous apportent une lumière encore plus éclatante :
1. « (Shi) ka Múlúba m’musonge. (Shi) ka musonge m’muluba : anka musonge na muluba m’bakunda.(= « Si ce n’est pas un Muluba, c’est un Musonge. Si ce n’est pas un Musonge, c’est un Muluba. En fait, un Musonge et un Muluba, ce sont tous deux des Bakunda »).
2. « Musonge m’muluba, shi ka Múlúba, M’mukunda », (= « un Musonge est un Muluba. S’il n’est pas Muluba, il est donc Mukunda. »)
3. «Musonge m’muluba, Múlúba m’mukunda. Nyuma ka mungi mbili », (= « un Musonge est un Múlúba. Un Múlúba est un Mukunda. Car la courbe de son dos n’a de pareille que lui-même[11] »).
Dans cet ordre, il est permis de penser que les Basonge appartiennent au groupe Baluba du Lomami et aux Bakunda — que certains auteurs identifient sous la figure géographique des Baluba du triangle Nord-Est.
De même, devrions-nous nous interroger : Mbidi Kiluwe (le père du deuxième empereur des Baluba, Kalala Ilunga), aurait-il été un sujet extra-luba lorsqu’on l’identifie parfois comme un sujet Mukunda (peuple situé entre les Territoires de Moba et Manono Est) ?
Les Bakunda (originellement Baluba) dont un descendant a été Mulopwe, le sont aussi politiquement à la suite de leur assujettissement postérieur au pouvoir central des Balopwe. Comme quoi, les Waruwa demeurent ethniquement Baluba.
En portant le même débat sur les Bahemba dits « purs », dont Delhaise et Ndaywel affirment qu’ils n’ont absolument rien de commun avec les Baluba. Ici il nous incombe tout simplement, à la suite de William Fagg, de soumettre cette problématique plutôt à une approche comparative à partir de l’analyse de certaines techniques artistiques, comme indiqué plus haut[12].
Et au niveau de la langue, l’argument le plus plausible est celui évoqué ci-haut par Thomas Reefe[13].
Rappelons que le kihemba est une langue apparentée au Kiluba, langue qui se parlait (avant Jésus-Christ !) jusqu’au Maniema.
Avec Verhulpen, il est même donné de voir que ceux à qui on dénie la légitimité du Buluba l’assument eux-mêmes sans ambigüité :
« Les indigènes de l’entre Lualaba-Tanganika, au Katanga, se disent Baluba dans les camps des soldats pour se différencier des Basonge, des Mongo, des Gombe, des Batetela, etc. Ils se disent Balumbu, Bakunda, Babui, Bakalanga, Batumbwe dans leur propre pays pour se différencier des Baluba du Lomami et des groupes voisins[14] ».
[1] E. Verhulpen, op.cit., p. 80.
[2] Kabamba Nkamany, op. cit., p.1.
[3] idem, p.94.
[4] Banza Mwepu Mulundwe, Le Mythe des origines des Baluba, éd. Dikasa, Lubumbashi, 2001, pp. 37-38. Nous laissons de côté la question que soulève cet auteur sur l’origine des Baluba
[5] P. Samain, La langue Kisonge, Bi Congo, cité par Verhulpen, op.cit. p.71.
[6] Aujourd’hui encore, et on peut le vérifier sur terrain, selon les zones dialectales du Buluba, les consonnes b et w, d, l et r s’interchangent librement. Par exemple : bukula à Kongolo, la farine, se prononce wukula à Lwabo dans le territoire de Kamina ; mwan’a bute à Kabanga ka Umpafu dans le Territoire de Ngandajika, l’aîné, se dit mwan’a wute à Kabondo Dianda dans le Territoire de Bukama ; mudilo à Lubangule dans le Territoire de Kabinda, le feu, se prononce mulilo chez les Bakwejimu dans le Territoire de Kongolo et mudiro à Butumba dans le Territoire de Bukama ; kutala à Kabongo centre, regarder, se dit kutara à Kibanda dans le Territoire de Bukama, à Kamayi dans le territoire de Kabongo, à Kalundwe dans le Territoire de Kaniama
[7] Delhaise, Bull. soc. Roy. Belge Géogr., 1908, 261, cité par J. Maes et O. Boone, op. cit., p.34.
[8] I. Ndaywel, op. cit., pp.135-136.
[9] P. Colle, Baluba 1, Bruxelles, 1913, p.1.
[10] J. Vansina, op. cit, p123.
[11] Proverbes récoltés auprès de Kasongo Ngoy Pauni, un Musonge de Kongolo et professeur de philosophie à l’Université de Lubumbashi.
[12] F. William, op. cit, p 144.
[13] T. Reefe. The Rainbow and Kings. A history of luba empire, to 1891, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, London, England, USA, 1981, p.74
[14] E. Verhulpen, op. cit., p. 64.
[1] E. Verhulpen., op.cit., p. 80.
[2] Idem, p.394.
[3] Crine-Mavar, op. cit., p. 49
[4] Vansina. J., op it. p123
[5] J. Vansina, op. cit., p. 123.
[6] F. William, Masques d’Afrique, dans les collections du Musée
Barbier Müller, éd. Fernand Nathan LEP, 1980, Suisse, p.144.
[7] T. Reefe, The Rainbow and Kings. A history of luba empire, to 1891, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, London, England, 1981, p.74.
[8] Les informations qui suivent nous ont été fournies par le Directeur de la Coopération Culturelle au ministère de la Culture et Arts à Kinshasa, Nyembo Simaundu Félix, un naturel Bangubangu.
[9] Le terme Bangobango ou Bangubangu est une allitération linguistique désignant les enfants de Kabango au Maniema (cf. encadré). C’est pourquoi, les BanguBangu pratiquent des relations de plaisanterie « oncle-neveu » avec les Balega (Bayomba). Ces faits sont rappelés rituellement lors des deuils, au cours desquels les oncles (bayomba) réclament leurs droits avant tout enterrement.
[10] La présence des Bahemba ailleurs qu’au Katanga serait justifiée par le récit que voici : « A la suite d’un partage controversé de gibier entre deux frères Bahemba, le grand frère voulant à tout prix avoir la meilleure part, le petit frère se résolut à quitter sa famille en prenant la direction de l’actuelle Kongolo. S’étant fixé sur ces dernières terres, il y reconstitua une nouvelle communauté hemba fractionnée aujourd’hui en Bahemba Bena Nkuvu, Bena Nyembo, Bena Yambula, Bena Mambwe… Noms qui se rapportent aux huit enfants qu’il engendra et qui, depuis, forment les huit chefferies actuelles ».


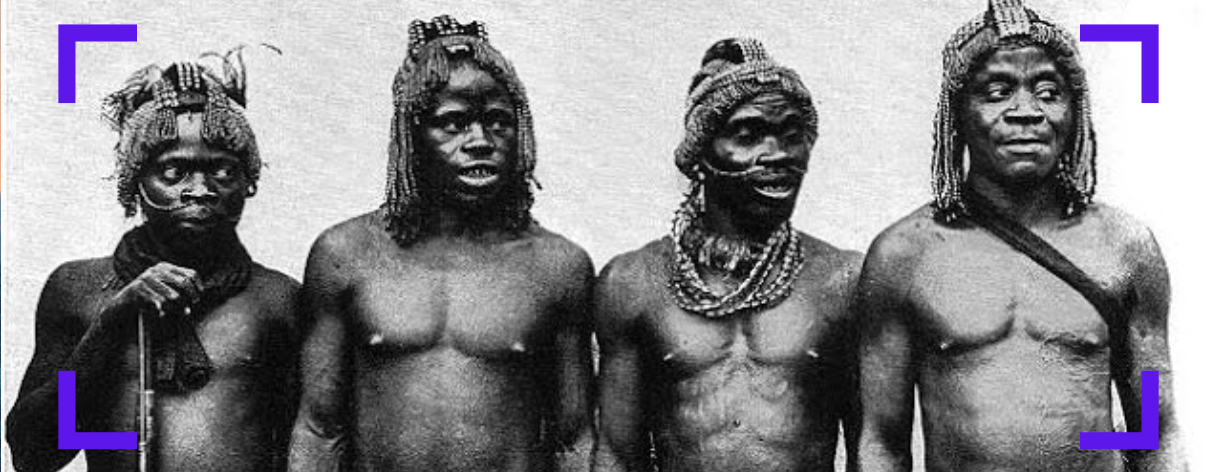

Commentaires