Royaume de Kalanga
Pour comprendre l’évolution politique de Nkumwimba Nkongolo Mwamba et les premiers stades de l’expansion de l’empire Baluba, il est crucial d’examiner le contexte politique de la région de sa naissance, de sa croissance et de sa mort. Bien qu’il soit parfois perçu comme un personnage sans importance, il est important de souligner que Mwamba était issu d’une lignée royale, ce qui confère à son origine une dimension bien plus profonde qu’on pourrait le croire.
Effectivement, il était issu d’une famille royale qui régnait sur un royaume prospère et opulent. Ce royaume, selon l’écrivain Makonga Bonaventure, s’appelait le Royaume des Bakalanga et était fondé par les Baluba Kalanga. Les Bakalanga sont les premiers à s’être structurés politiquement et remontent leur royaume à l’époque de Kasongo Kaunga. Nous avons eu l’occasion de discuter avec le chef Kibombwe, rencontré à Kimona, ainsi qu’avec Kayembe Mukona, à Kamungu. Ils nous ont fait découvrir les palettes de Lukasa, où l’histoire de Kasongo Kaunga a été transcrite :
« Les Baluba de l’Antiquité ont créé une société harmonieuse et profondément spirituelle, centrée sur le Butobo, une pratique religieuse qui régissait la société par un ordre divin et social. Ce système, fondé sur le respect des traditions et dirigé par les Voyants-sacrificateurs (les Bitobo), assurait une harmonie sociale durable, car la religion régissait tous les aspects de la vie quotidienne. La justice, l’éducation, les rites de passage et les décisions politiques étaient tous régis par des principes religieux, hérités de génération en génération. C’est alors qu’est apparue Kasongo Kaunga (à ne pas confondre avec Kasongo Kamwandi wa Sanga[1]), une figure fascinante et progressiste, qui a accédé au trône du royaume de Kalanga. Contrairement à ses prédécesseurs, il remit en question la fusion du pouvoir spirituel et politique. Il rencontra rapidement les Bitobo, qui étaient les gardiens de l’ordre établi et ne souhaitaient pas que leur autorité sur les chefs et les décisions du royaume soit remise en question. Ils voulaient à tout prix préserver le système de la sacerdocratie, dans lequel les dirigeants politiques n’étaient que des exécutants, soumis à l’influence spirituelle des initiés.
Kasongo Kaunga, inspiré par une vision réformatrice du pouvoir, décida alors de séparer les affaires politiques des affaires religieuses. Cette décision marqua un tournant crucial dans l’histoire politique des Baluba, annonçant la naissance d’un État organisé autour de principes de gestion profanes. Il édicta un ensemble de principes, appelés « miyala », qui devinrent les fondations d’un code social en perpétuelle mutation. Ce code régissait la vie collective, distribuait des rôles et des obligations à chacun, et établissait une justice impartiale et accessible à tous. Bien qu’il cherchât à réformer, les dirigeants restaient soumis à l’influence de la secte de Mbudye, qui faisait office d’intermédiaire entre l’ancien et le nouvel ordre. Kasongo Kaunga, qui était un visionnaire avant son temps, tenta d’étendre son pouvoir au-delà des limites conventionnelles en engageant des mesures militaires d’expansion. Toutefois, cela entrera en conflit avec les intérêts des groupes religieux conservateurs et des factions souhaitant assurer la stabilité du royaume. Il fut arrêté et pendu, victime de son audace politique. Avant de mourir, il prophétisa : « Les Baluba s’uniront en un seul État, adoptant le Bulopwe comme système politique, et lanceront une campagne militaire pour étendre leur territoire. » Ce texte sert maintenant de point de départ aux générations futures, symbolisant leur union et leur renouveau. D’après les mythes ancestraux, l’arrivée de Kasongo Kaunga marque le commencement d’une époque nouvelle dans l’histoire des Kiluba. Il représente également une séparation nette avec un passé dominé par le sacré, au cours duquel la langue kibemba vit le jour. D’après la tradition, l’intervalle de temps entre la mort de l’individu et l’émergence de l’État unitaire est désigné par l’expression « kepadi myaka tununu tusamba tubidi ne makumi abidi ne itano ».
L’avènement de Kasongo Kaunga, qui a fondé le royaume des Kalanga, constitue une période importante, car les anciens Baluba ont commencé à vivre dans un nouveau cycle social, désormais déspiritualisé. Cet évènement de Kasongo Kaunga marque le début de l’an 1 des Baluba. Les analyses ethnolinguistiques nous permettent de situer cet évènement vers l’an -25 avant notre ère, puisque ce moment correspond au début de la séparation linguistique entre le kiluba et le kibemba. En effet, Thomas Q. Reefe et Joseph Hoover, qui ont réalisé une analyse lexicostatistique en 1970, ont conclu que ces deux langues se sont séparées il y a environ 2000 ans (Reefe, 1981 : 74). En effet, lorsque nous nous situons en 1970, ces 2 000 ans nous font remonter approximativement à l’année 25 avant Jésus-Christ. Cet indice nous permet, grâce à la cohérence entre les traditions et les analyses scientifiques, de confirmer que la nouvelle ère kiluba a commencé avec Kasongo Kaunga, comme le disent les Anciens. Elle débuta en 25 av. J.-C., soit l’an 1 du calendrier kiluba. Le règne des Kalanga a réellement commencé en l’an 1, soit il y a 25 ans avant notre ère, sous la direction de Kasongo Kaunga. Il a établi un royaume hiérarchisé, ce qui lui a permis de créer un régime politique dominant sur plusieurs tribus. Par conséquent, nous désignerons cette entité comme le « Royaume de Kalanga », même si certains chercheurs, notamment Mulundwe, Bonaventure Makonga et Patrick Kalenga, choisissent plutôt de l’appeler le « Bakalanga ».
Selon Kalenga Patrick, ce royaume existerait depuis bien avant notre ère actuelle. Mulundwe soutient que c’était le premier royaume d’Afrique centrale (Mulundwe, 2001 : 61-62). Makonga ajoute que le Conseil royal dirigeait ce royaume et que ses décisions étaient respectées, même par le souverain (Makonga, 1948 : 301-307). L’histoire bien connue et facilement racontée de ce royaume commence avec un certain Nkunga Kahata Kalanga, dont Patrick fait remonter l’existence au cinquième siècle de notre ère.
Les récits entourant la naissance de ce souverain et les prémices de son règne peuvent sembler légendaires, mais Patrick Kalenga, avec l’aide de Makonga Bonaventure, a établi une liste relativement précise des souverains qui ont régné sur le royaume pendant les cinquième, sixième, septième et huitième siècle. Grâce à leur collaboration de 1980 à 1995, ils ont pu reconstituer la lignée des monarques à partir des traditions et des phénomènes sociaux et évaluer la durée de chaque règne. Selon la tradition des Bakalanga, la succession se faisait de manière pacifique, avec un intervalle de cinq ans entre chaque règne. Ce processus était lié à une série de cérémonies royales, qui se tenaient exclusivement en saison sèche. Si un différend survenait lors d’une transition, le laps de temps requis pourrait excéder cinq ans.
Le règne du tout premier monarque, Nkunga Kahata Kalanga, s’étendit de l’an 400 à l’an 410. Après lui, son fils, Longo Nkumwimba, prit le pouvoir, régnant de 415 à 420. Bien que le défunt souverain eût choisi son frère Mutenga Kaholo comme successeur, la cour royale décida finalement d’élire le fils de Nkunga, Kabange Ka Mbuyu.
Mutenga Kaholo et ses partisans s’opposèrent à cette décision, car Kabange était encore un enfant et sa mère ne venait pas de Buleya, la première capitale. Cet affrontement donna lieu à la première guerre interne dans l’histoire des Kalanga, qui dura quinze ans, de 440 à 455. Ce n’est qu’après le trépas de Mutenga que les cérémonies pour introniser Kabange Ka Mbuyu purent être planifiées, inaugurant ainsi un règne glorieux s’étendant sur deux décennies, de 460 à 480.
Après les traumatismes causés par la guerre de quinze ans, les anciens du royaume de Kalanga établirent une règle de succession claire : le défunt souverain serait dorénavant remplacé uniquement par son premier fils ou sa première fille. C’est ainsi que la première femme à monter sur le trône, Malungo Keta Mbuyu, devint reine en 485 et ce, jusqu’en 510. Sous son règne, le royaume connut une expansion considérable, atteignant le fleuve Lwalaba à l’est, la forêt de Manwema, aujourd’hui située dans le territoire de Kongolo, et le Kivu, au nord.
Après son décès, son fils, Kalowa Ilunga Kato, lui succéda et régna de 515 à 526, puis il mourut de vieillesse. Son successeur, Mwenze Ngoyi Mwimbi, monta sur le trône en 531 et régna pendant dix-neuf ans. Il se distingua en encourageant l’artisanat, en particulier la forge, et en développant des échanges commerciaux avec le royaume de Buhémba.
Konga Lenge, successeur de Mwenze, ne régna que de 555 à 564 avant de mourir à la suite d’une morsure de serpent. Sa fille aînée, Kitwa Lukunga, est ensuite montée sur le trône et a régné pendant seize ans, de 570 à 587. Elle marqua son règne par des réformes agricoles, notamment l’introduction de la culture intensive de l’igname sauvage, renforçant ainsi le développement du royaume. Son fils, Kalulu Mpyana Monga, accéda au trône en 592. Il y régna pendant six ans, mais son règne, jugé trop paisible, fut moins remarquable que celui de sa mère. Son propre fils, Kayumba Kahanda, l’empoisonna et prit le pouvoir, régnant de 613 à 620. Comme il le désirait, ce dernier fut enterré à l’entrée du village de Buleya.
Milundu wa Ngé, successeur de Kayumba, régna brièvement, de 625 à 630. Il fut remplacé par Nkongolo Mukulu, qui monta sur le trône avant d’avoir terminé les rites de couronnement. Il régna de 630 à 655. Son fils, Nkongolo Miketo, connu pour ses prouesses guerrières et son talent de chasseur, lui succéda de 660 à 675. Malheureusement, il fut mortellement blessé par des flèches empoisonnées lors d’une embuscade, ce qui déclencha un conflit armé et empêcha la célébration des rites de passage au leadership.
Kasongo Nkongolo régna ensuite de 675 à 681, avant d’être assassiné par le fils de Nkongolo, Nkongolo Mwana, qui prit le pouvoir de 682 à 690. Pour éviter des représailles, il s’installa chez les Baluba de Mutombo Mukulu, où il réorganisa son pouvoir tout en tentant d’annexer ce territoire au royaume de Kalanga. Il devint une figure emblématique de cette région, mais on le confond parfois avec Nkongolo Mwamba. Il revint à Buleya, mais mourut subitement après avoir traversé le village de Kimona.
Kalenga Nshimbu Mwila, descendant de Nkongolo Mwana, accéda au trône en 690 et régna jusqu’en 700. Il périt à cause d’une morsure de serpent et fut remplacé par son fils, Kalenga Masanza Mamba, qui régna de 700 à 744. C’est sous son règne qu’on reconnut pour la première fois, d’après les récits de Nkongolo Mwana, que les habitants de Mutombo Mukulu étaient des Baluba. Il a initié une politique de réunification des Baluba en un seul royaume. Pendant sa visite à Mutombo Mukulu, où la princesse Cifinga Cibal régnait, cette dernière, bien qu’associée à Nkongolo Mwana, n’a montré ni hostilité ni enthousiasme pour le projet.
Décidé à unifier pacifiquement les Baluba, Kalenga Masanza Mamba déplaça la capitale politique du royaume à Bukunga, qui se trouve en son centre. Malgré ses efforts, il n’a pas réussi à réaliser son ambition d’unification. Son règne, cependant, demeure l’un des plus longs et des plus marquants de l’histoire du royaume.
Origine et engagement militaire de Nkumwimba Nkongolo Mwamba
Nkumwimba Nkongolo Mwamba, contrairement à ce que certains récits voudraient nous faire croire, n’était pas un roturier, mais plutôt un noble des Baluba ba Kalanga. Il est né à Kisanga et y a vécu ses seize premières années avant de s’engager dans l’armée de Kalenga Masanza Mamba, un dirigeant partageant sa vision de l’unification politique des Baluba. Sous la direction de Kapangala Kabamba, un général de guerre renommé pour sa bravoure et son expérience des combats, Nkongolo Mwamba a reçu une formation militaire exigeante. Toutefois, Kalenga Masanza Mamba, dont la pensée pacifiste se concentrait sur le commerce et la prospérité économique, a accordé peu d’importance au renforcement des forces militaires. Il accorda plutôt la priorité à l’exploitation et à la vente des salines africaines, une ressource stratégique pour le royaume. Cette économie florissante contribua indéniablement à l’accumulation de richesse du royaume de Kalanga. Cependant, elle affaiblit sa puissance militaire en raison de la démobilisation des vétérans et généraux issus de l’armée de Nkongolo Mwana. Conscient de cette vulnérabilité stratégique et convaincu qu’une force militaire solide était nécessaire pour unifier politiquement tous les Baluba, Nkongolo décida de redynamiser la formation militaire et d’entreprendre une politique expansionniste. Ainsi, comme le souligne Makonga, sa détermination et ses actions étaient motivées par la conviction profonde qu’une force militaire était nécessaire pour résoudre les conflits internes et unifier les Baluba :
« En effet, quand il eut atteint l’âge d’homme, il commença par se faire des adeptes de son choix parmi les braves jeunes Bakalanga » (Makonga, 1948 : 307).
Anticipant la mort imminente de Kalenga Masanza Mamba, Nkumwimba Nkongolo Mwamba alla trouver Kapangala Kabamba, qui était réputé pour son expertise militaire. La tradition orale dit que leur rencontre eut lieu dans un village appelé plus tard Kitenta Kikatampe, proche du village de Kalema, sur le territoire actuel de Kabongo. Kapangala Kabamba, réalisant les aspirations politiques et militaires de Nkongolo Mwamba, l’encouragea à former une armée puissante, un prérequis indispensable pour unifier les royaumes des Baluba. Suivant les enseignements de Kapangala, Nkumwimba Nkongolo entreprit de former une armée structurée et disciplinée. Il s’y consacra avec détermination. Selon Womersley, ce processus a marqué un tournant décisif dans son cheminement personnel. La création d’une force militaire puissante reflétait sa vision stratégique. Il voulait ainsi établir une domination politique par la force et combler les faiblesses militaires du royaume de Kalanga. Cette armée, conçue non seulement pour défendre les territoires existants, mais aussi pour mener des campagnes d’expansion, devint un outil central dans la réalisation des ambitions de Nkongolo Mwamba. Elle ouvrit la voie à une ère de consolidation et d’expansion territoriale :
« Vers la fin de la vie de Kalenga Masanza, le tyran Kongolo était un jeune homme en pleine ascension, s’imposant dans la même région en tuant et en conquérant à tout-va » (Womersley, 1984 : 4).
Bien que cette citation semble être teintée d’ironie, il est important de noter que Nkongolo Mwamba planifiait déjà son accession au trône du royaume de Kalanga. Pour trouver des alliés et recruter, Nkongolo Mwamba a quitté Kisanga pour s’établir dans un village stratégiquement situé entre Kampemba et Kipukwe, le long de la route reliant Kamina à Kabongo, en passant par Zwibi. On peut toujours voir les vestiges imposants de ses palais. Ce village était situé près de la rivière Kilubi (Womersley, 1981 : 2). Après avoir consolidé son pouvoir militaire dans la région, Nkongolo Mwamba s’établit sur l’île de Kongolo, située dans le territoire actuel de Kongolo, près du fleuve Lwalaba. Il y recruta beaucoup de jeunes Bakalanga, qu’il entraîna militairement pendant une certaine période. Par la suite, il établit temporairement sa résidence à Katonkole, sur la rive ouest de la rivière Lumami, juste au sud du bac actuel, près du village et de l’ancien poste de coton de Mani. On peut toujours observer un cercle d’arbres qui, selon la tradition, marquerait l’emplacement de la clôture de Kongolo. Après avoir quitté Katonkole, Nkongolo Mwamba s’installa à Kalumbu, non loin de Lubyai. Ce village, autrefois prospère, devint son quartier général en raison de sa position centrale, qui facilitait la coordination de ses campagnes militaires imminentes et la gestion des vastes terres qu’il souhaitait conquérir.
Unification politique
Après avoir formé une redoutable armée de guerriers, Nkumwimba Nkongolo, âgé de seulement vingt-cinq ans, rencontra le chef Mangembe de Kabobwe. Ce dernier était vassal de Numbi Kasheha Mikonzo Mwine Mato Adi, fils et successeur du grand chef Nyungu Nyungu du pays de Madia. Nkongolo présenta son plan d’unification des Baluba, que Mangembe accueillit favorablement. Ils unirent leurs forces pour déclarer la guerre à Numbi Kasheha Mikonzo Mwine Mato Adi, puis à Monga Ngoyi Yañgagole. Il est important de mentionner que Nkongolo Mwamba a aussi visité la reine Tshimbale Mbande, dont le territoire correspond à celui actuel de Mutombo Mukulu, et qui a également accepté l’idée d’unification. Cependant, la guerre pour atteindre cet objectif a duré près de dix ans, car de nombreux clans, jadis autonomes, ont opposé une farouche résistance à ce projet. De surcroît, il fut nécessaire d’employer la force pour vaincre cette résistance. Pendant cette période troublée, que certains ont qualifiée de « sainteté », Kalenga Masanza Mamba a essayé de persuader Nkumwimba Nkongolo Mwamba d’abandonner ses ambitions, mais il a perdu la vie en faisant cela.
Les soldats de Kalenga Masanza Mamba s’efforcèrent de prévenir Nkongolo Mwamba d’accéder au pouvoir, mais ils durent se rendre à l’évidence : Mwamba avait déjà préparé son coup et ne rêvait que de devenir le souverain des Baluba ba Kalanga. Une fois que les partisans de Kalenga Masanza Mamba eurent été vaincus, Banza Mijibu Kalenga, le conseiller personnel de Nkongolo Mwamba, un voyant-sacrificateur (Kitobo), lui rappela qu’il venait d’accomplir un oracle vieux de plusieurs siècles, prophétisé par Nkulu wa Manyinga. Selon cette prédiction, les Baluba devaient unir leurs forces et créer un État unifié, le Bulopwe, et leur capitale serait Mwibele Ntanda. Nkongolo Mwamba demanda à Banza Mijibu quelle marche il devait suivre. Ce dernier lui recommanda de s’établir à Mwibele Ntanda, conformément aux prédictions des ancêtres. C’est ainsi que, le 15 juillet 755, Nkongolo Mwamba convoqua une assemblée à Mwibele Ntanda, qui fut fréquentée par les Baluba de Bukama, de Mutombo Mukulu, de Kongolo et d’autres régions, scellant l’unification politique de tous ces peuples. Lors de cette cérémonie historique, Nkongolo Mwamba prononça un discours, qu’il termina ainsi :
« Buluba i bukata, Buluba i bumo, Buluba i amiwa, Buluba i abe, Buluba i batwe. Hamo tukombaka ino ntanda ya Buluba. Ndoe ne sangaji yo nsulo ya kwibungila, yo mpalo yetu. Tudi bana ba munzo umo, tufwaninwe twikale hamo mwa kulamina ntanda ya shile bankambo.: Buluba est vaste, mais il est uni. Nous formons une seule nation, car le Buluba est dans nos cœurs. Ensemble, nous bâtirons ce pays. Nous aspirons à la joie et au bonheur de tous les Baluba. Notre unité est la clé de notre succès. Nous sommes d’une même race et nous devons nous unir pour préserver ce pays qui nous a été légué par les générations passées et qui est notre héritage commun que nous ont légué les ancêtres[2] ».
Ce discours est resté authentique au sein de la confrérie de Bumbudye. Il résonne profondément dans le cœur de tous les Baluba. En effet, ce discours est désormais la devise de l’association socioculturelle des Baluba, qui l’énonce ainsi : Buluba i bukata, Buluba i bumo, Buluba i bungi. Le professeur Mutonkole le résume ainsi :
« Le Múlúba peut commettre des erreurs en parlant ou en raisonnant, il ne peut pas oublier le chemin qui mène chez lui. Il connaît ses origines et son peuple, il connaît la voie de l’unité et de l’harmonie de son peuple. Il ne peut donc oublier son pays natal et ne peut trahir sa communauté » (Mutonkole, 2007 : 97).
Nkumwimba Nkongolo Mwamba est un grand leader militaire et politique, mais il est peu connu dans l’histoire générale de l’Afrique. Et pour souiller son image, les rares écrits parlant de lui, lui décrit comme étant « un tyran, un mauvais, un homme qui faisait couper les bras et oreiller de tout individu qui n’obéissait pas à ses ordres » (Verhulpen, 1936 : 92).
Certains textes mettent en évidence un geste terrible commis par ce monarque : l’inhumation prématurée de sa mère, Mwamba. Cependant, malgré ce méfait, Nkumwimba Nkongolo Mwamba est vénéré par les Baluba comme le fondateur de l’unité globale du peuple Bulopwe. Il est également reconnu comme un grand bâtisseur, ayant fait ériger des tours en bois de dix à vingt étages, recouvertes d’argile de diverses couleurs, dont le blanc, le noir et le jaune. Cette approche audacieuse a permis aux Baluba, qui se sont installés au Zimbabwe actuel au XVe siècle, de bâtir des temples en pierre, qui sont aujourd’hui en ruines. Ces temples témoignent de la grandeur des peuples Kalanga, qui ont bâti ces structures imposantes (Mulundwe, 2001 : 38). Nkumwimba Nkongolo Mwamba ne s’est pas seulement intéressé à l’architecture, mais a également été un ardent défenseur de la culture et de la civilisation. Placide Tempels a étudié la philosophie des Baluba, mais son travail a suscité des critiques pour une injustice commise envers ce peuple. En effet, Tempels a intitulé son livre « la philosophie bantoue », alors qu’il s’était exclusivement concentré sur les Baluba dans ses recherches. Si une généralisation avait été justifiée, il aurait été préférable de mettre en évidence la singularité de chaque communauté culturelle en leur attribuant ce qui leur est dû. Aujourd’hui, tout le monde s’entend pour reconnaître que cet ouvrage constitue une source incontournable pour l’étude de la philosophie en Afrique et dans le monde. Cependant, si Tempels avait intitulé son travail « La philosophie des Baluba », cela aurait certainement contribué à une meilleure reconnaissance et à un plus grand rayonnement de ce peuple.
La durée de son règne sur l’Empire
Le mystère entourant le règne de Nkongolo Mwamba reste entier, faute de sources historiques éclairant spécifiquement ce sujet. Néanmoins, comme il a été mentionné précédemment, Nkongolo Mwamba, fils de Muleya Monga et de Mwamba Ndai Malungo, a entamé à l’âge de vingt ans une guerre d’unification qui a duré dix ans. Comme on sait que l’Empire Kiluba a été créé en 700 (l’an 675 grégorien), qu’une décennie a été nécessaire pour mener à bien la guerre d’unification, et que Nkongolo Mwamba est devenu le dirigeant suprême, ou Mulopwe, des Baluba en 755, alors âgé de seulement 35 ans, nous pouvons déduire qu’il a entamé sa campagne unificatrice en 740. La durée de son règne peut être établie grâce aux sources historiques, qui mentionnent qu’il a régné pendant 52 ans, soit de 755 à 807. Malgré la rareté des documents disponibles, ces derniers fournissent néanmoins des informations clés sur la chronologie du règne de ce souverain légendaire. Tout d’abord, en se référant aux récits des événements entourant Kalala Ilunga, Lukanda révèle que Kalala Ilunga est le fils de Kakenda Ilunga Mbidi Kiluwe et de Ngoyi Bulanda, la sœur de Nkongolo Mwamba (Lukanda, 2018 : 159).
Bavure et malédiction
Selon la tradition, Nkumwimba Nkongolo Mwamba aurait commis un acte répréhensible et se serait ainsi attiré une malédiction. Au cours de son séjour à Kimona, Nkongolo Mwamba aurait attaqué une vieille dame nommée Kilonda wa Senga. En guise de représailles, elle a mélangé des cendres provenant du crâne d’un lézard rare appelé Kilonko avec un puissant sortilège. Elle a ainsi maudit Nkongolo Mwamba, lui ordonnant de quitter la ville sur-le-champ. Elle a même ajouté qu’il ne serait plus jamais autorisé à mettre les pieds dans la ville, que ce soit pendant sa vie ou après sa mort. Après avoir subi cette terrible malédiction, Nkongolo Mwamba n’a plus jamais mis les pieds à Kimona. Selon la tradition, cette malédiction aurait bel et bien été accomplie. En effet, lorsque les troupes de Kalala Ilunga ont capturé et décapité Nkongolo Mwamba, elles ont emporté sa tête et se sont dirigées vers la région de Mpasu, où se trouvait Kalala Ilunga. Cependant, elles ont commis une terrible erreur en s’arrêtant pour se reposer à l’entrée de la ville sacrée de Kimona. Durant cet arrêt, celui qui transporte la tête de Nkongolo Mwamba la pose par terre. Soudain, à leur plus grand étonnement, ils observèrent que la tête s’était métamorphosée en quelque chose ressemblant à une fourmilière. Cette métamorphose fut considérée comme une manifestation des effets du sang de Nkumwimba Nkongolo Mwamba, qui, en touchant le sol sacré de Kimona, avait déclenché une réaction surnaturelle :
« Les guerriers de Kalala Ilunga arrivèrent, brandissant la tête de Mulopwe Nkumwimba Nkongolo Mwamba. Cependant, ils ignoraient que la malédiction prononcée contre lui l’empêchait formellement de poser un pied sur le sol de la ville sainte de Kimona. C’est alors que les membres de l’assemblée déposèrent la tête du défunt par terre. Quand le sang de Mulopwe toucha le sol, il se passa quelque chose d’étrange : la tête du souverain se transforma en termitière, et le sang altéra aussi la couleur du sol, qui devint rouge. Ce changement de teinte était sans précédent dans l’histoire de cette terre. Cette transformation s’est produite entre Mahongo et Kimona, laissant une empreinte indélébile dans la mémoire et le paysage de cette région[3] ».Sashila, qui a été invitée à témoigner, a approuvé cette thèse. Il souligne, en outre, que la terre de la ville de Kimona conserve encore sa couleur rouge caractéristique. Cette particularité durable, selon lui, découle des événements historiques précédents. Sashila poursuit :
« Lorsque les militaires ont aperçu la tête se métamorphoser en un essaim de fourmis, ils ont été saisis de terreur et ont rapidement fait demi-tour pour retourner dans la cité. À ce moment, on leur rappela la malédiction associée à Nkongolo Mwamba. Selon la tradition, si une partie de son corps touchait le sol sacré de Kimona, des conséquences surnaturelles surviendraient. Par ailleurs, il fut également souligné qu’aucun Mulopwe n’est autorisé à fouler le sol de cette cité sacrée, ni même à la contempler. Lorsqu’ils traversent la ville, les Balopwe doivent être portés sur les épaules, et leurs yeux doivent être bandés pour respecter l’interdit ancestral. Cependant, jusqu’à maintenant, aucun événement concret n’a été apporté pour expliquer pourquoi cet interdit existe. En d’autres termes, aucun Mulopwe n’a encore transgressé cette règle ni expérimenté les conséquences supposées de marcher sur le sol ou de contempler directement la terre de cette cité sacrée[4]».
Conclusion
Nkumwimba Nkongolo Mwamba était le fils de Kahata Muleya Monga et de Mwamba Ndai Malungo, tous deux membres du clan des bene-Mbayo et originaires de la cité de Buleya, située au nord de Kabongo à environ 80 kilomètres de Mwibele. Il serait né le 2 décembre 720. À l’âge de vingt ans, il a lancé la guerre d’unification des Baluba en 740, qui a duré dix ans, jusqu’en 750. En juillet 755, il eut trente-cinq ans, il devint Mulopwe. Il fonda ainsi le Grand Empire, qui régna durant sept cent cinquante ans, soit 1300 ans, de juillet 700 au 5 août 1888. Il gouverna cet empire grâce à l’appui de son armée, dirigée par son jeune neveu Kalala Ilunga, fils de Mbidi Kiluwe. Il est important de noter que Kalala Ilunga n’a jamais confronté Nkongolo Mwamba directement et qu’il n’était pas présent lors de la mort de son oncle. En réalité, il était à Mpasu, poursuivant le fils du chef Mangembe de Kabobwe, Wilema Mangembe, ainsi que d’autres partisans royalistes de Nkongolo Mwamba. Ces derniers tentaient de rallier les forces pour combattre l’armée de Kalala Ilunga.
D’après la tradition, des guerriers ont capturé et décapité Nkumwimba Nkongolo Mwamba, avant d’envoyer sa tête à Kalala Ilunga. Toutefois, en cours de route, la tête se transforma en une fourmilière entre Mahongo et Kimona. Selon la tradition, le sang du chef, lorsqu’il toucha le sol, teinta la terre d’un rouge inusité, ce qui n’avait jamais été observé auparavant. En ce qui a trait à la succession, Kalala Ilunga ne s’est pas proclamé Mulopwe immédiatement. Il a dû rivaliser pour le pouvoir avec le fils de Nkongolo Mwamba. Ce n’est qu’après avoir vaincu ce dernier qu’il subit le Kutomboka et devint officiellement Mulopwe en 808, s’installant à Munza, qui est aujourd’hui connu sous le nom de gare Kamunza.
[1] Banza Mijibu I et Kasongo Kamwandi wa Sanga sont des contemporains qui, selon la tradition, se sont rencontrés à Mulombi et ont scellé un pacte de sang. Ce pacte stipulait que leurs enfants devraient se marier. Banza Mijibu venait de la région de Kabongo et avait six garçons, tandis que Sanga avait plusieurs filles et garçons. Ce sont ces unions entre ces deux familles qui ont donné naissance à l’ethnie des Baluba d’aujourd’hui.
[2] Ilunga Djoji (H†). Age 87 ans. Notable coutumier et membre de la confrérie Mbudye. Information recueillie à Kamwenze, le 14 août 2022. Il est malheureusement décédé à mars 2024.
[3] Mona Mbutwile (H†). Age 80 ans. Kitobo et gardien de la forêt sacrée. Information accueillie à Kimona, le 07 juillet 2018.
[4] Sashila Mutombo (H). Âge approximatif 85 ans. Griot ou historien traditionnel. Information recueillie à Lenge Gare, territoire de Kabongo, 16 mai 2022.


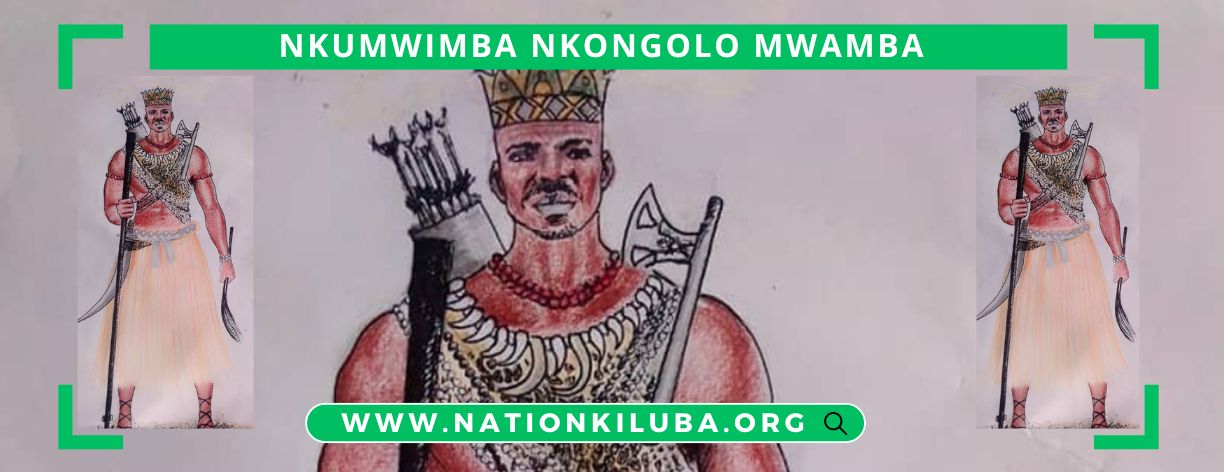
Commentaires