Les Baluba sont connus dans l’histoire africaine comme le grand peuple organisateur. En effet, le système politique a servi comme le modèle ou formule de gouvernance politique pour la plupart des peuples d’Afrique centrale et australe.
Le système politique des Baluba est le Bulopwe et le souverain ou chef d’État est appelé Mulopwe, Balopwe au pluriel. Le Bulopwe est fondé sur deux principes : celui de Butobo ou le sacerdoce, il s’agit là du pouvoir sacerdotal. Cosmologiquement, les Baluba croient que le Bulopwe a été donné à l’homme par son créateur pour représenter la souveraineté céleste sur la terre. Les symboles de Bulopwe sont : le feu, le kaolin blanc et l’arc (Lukanda, 2018 : 15-16). Le Mulopwe est donc une personne suprahumaine, il représente Dieu. Selon Mutonkole, le Bulopwe est soumis au pouvoir de Butobo détenu par un Kitobo (Grand Prêtre). Le Mulopwe ne règne donc pas seul, il est assisté ainsi par des prêtres qui représentent les Esprits et Divinités.
Si le Bulopwe est une gouvernance politique divine, l’État ou Empire des Baluba relève de maturité sociopolitique des Baluba. Ces derniers étaient d’abord organisés en village sous système politique dit le Bufumu. Il s’agit d’une organisation politique locale. Les anciens rapportent que plus les Baluba s’étendaient sur le Buluba, naquit la volonté de coopération entre villages. De cette coopération naquit ainsi le Bulolo ou chefferie qui est le pouvoir régional. C’est ainsi qu’on a vu le regroupement des villages sous la direction politique d’un chef appelé Kilolo, Bilolo au pluriel. Ces Bilolo régnaient souvent sur leurs clans et plus les clans s’étendaient et devenu les tribus naquit l’organisation politique provincial dit Nsala ou royaume. Le royaume regroupait généralement que les Baluba d’une même tribu. Celle-ci est l’ensemble de clans issus d’un seul ancêtre. Les premiers royaumes des Baluba ont été le Royaume de Kalanga, Royaume de Kibawa Upemba, Royaume de Milumbu, Royaume de Mutombo.
Le Royaume de Kalanga a été fondé par Nkunga Kahata Kalanga. La tradition a retenu l’ordre de règne de la manière suivante :
- Nkunga Kahata Kalanga
- Longo Nkumwimba
- Kabanga ka Mbuyu
- Kalowa Ilunga
- Mwenze Ngoyi
- Konga Lege
- Kitwa Lukunga
- Kalulu Mpyana
- Kayumba Kahanda
- Milundu Ya Ngé Kasongo Nkongolo
- Nkongolo Mukulu (Le Grand)
- Nkongolo Miketo (Le Flèche)
- Nkongolo Mwana (Le Petit)
- Kalenga Masanza Mamba
- Nkumwimba Nkongolo Mwamba.
Le Royaume de Kibawa Upemba :
- Mwimb’a Nkunda
- Disala dya Bupemba
- Kibawa Mbuyu
- Kibinda Ntenga
- Mukena Ngé
- Mukaya Nshimbu
- Kasongo Mwimba
- Mwimba
- Kankolwe Ka Kenda,
- Dito dya Boya
- Kanyema Mbidi
- Ilunga Sendwe Mwalaba
- Ilunga Kakenda Mbidi.
C’est à Kalenga Masanza Mamba que l’on doit la première tentative d’unification poli- tique des Baluba. Grâce à l’exploitation du sel, il acquit une influence économique considérable dans la région et au-delà de son royaume, devenant chef de plusieurs clans et tribus kiluba (Womersley, 1984 : 3-4). Malgré ses 44 ans de règne, il ne parvint pas à réaliser pleinement l’unification politique. Il fut remplacé par son neveu Nkumwimba Nkongolo Mwamba, qui abandonna la voie pacifique pour entamer une guerre d’unification. Celui-ci regroupa les Baluba sous unique direction politique (Sendwe, 1954 :113) et régna pendant plus de 55 ans. Bien qu’il n’ait pas réussi à unir tous les Baluba, Nkongolo Mwamba est entré dans l’histoire comme le tout premier empereur des Baluba.
Il a fallu l’avènement et l’ascension au pouvoir de Kalala Ilunga de son vrai nom d’Ilunga Lwaala Misaha, pour réaliser l’unité de tous les Baluba au sein d’un empire unique. L’État ou Empire des Baluba ne relève donc pas de la mythologie comme certains auteurs du XXe siècle l’ont écrit. Cet Empire est l’aboutissement d’un long processus de maturation sociopolitique des Baluba qui avaient compris la nécessité de l’unité politique et ils ont réalisé ce projet politique donnant naissance à la nation des Baluba homogène et unifiée du Nord au Sud et d’Est à l’Ouest. Professeur Pierre Petit nous informe :
« Les Luba ont très tôt subordonné un ancien modèle politique basé sur les liens de parenté à celui d’une structure étatique originale, à caractère supranational. Ce processus précoce ne doit rien à une quelconque influence extérieure, européenne ou arabe. A son apogée au dix-neuvième siècle, le royaume contrôlait un territoire de 200 000 km2 environ. Une telle intégration de peuples sous une même autorité n’a guère d’équivalents en Afrique centrale. Des sociétés éloignées parfois d’un millier de kilomètres de la capitale luba revendiquent dans leurs traditions une ascendance commune avec ce peuple, révélant ainsi le grand prestige de cette civilisation. Même le très puissant royaume lunda fut, selon la tradition, fondé par un prince luba. Et sur la carte du Musée de Livingstone représentant les migrations des ethnies de Zambie, le visiteur qui prend la peine de remonter les flèches aboutit immanquablement, en dernière analyse, au pays luba » (Petit, 1993 : 6).
Ce texte nous fournit deux informations sur l’État Kiluba, la première est celle qui confirme que l’État kiluba était une fédération politique des structures pré-empires fondées par les tribus des Baluba dont nous avons pu illustrer avec les deux royaumes celui des Kalanga et Kunda qui ont été réunis pour former l’État kiluba. La deuxième information concerne la grandeur de l’empire qui représente un aboutissement de maturation politique.
Émergence de l’organisation politique kiluba
L’histoire politique kiluba peut être retracé à partir de la séquence archéologique. Petit avance à ce propos :
« Il est peu de peuples en Afrique centrale pour lesquels on possède une séquence archéologique complète ; les Luba sont à cet égard privilégiés. Depuis longtemps, la dépression de l’Upemba était connue pour abriter des nécropoles de l’âge du fer (…).
Ce qui étonne le plus, c’est la grande continuité historique qui se dégage : le matériel qu’on exhume des tombes les plus anciennes (VIIIème siècle A.D.) est fort semblable à celui des plus récentes, datant d’il y a deux ou trois siècles. Les techniques de la poterie, par exemple, restent fondamentalement similaires. Il n’y a pas de discontinuité flagrante entre les tombes des différentes époques, ce qui met à mal l’idée de brusques vagues de migration qui se seraient poussées les unes les autres, comme le laisseraient croire les traditions historiques orales. Un autre grand acquis de l’archéologie est l’importance qu’a prise le commerce au cours des siècles.
On trouve ainsi dans ces tombes des coquillages venus de l’océan, ainsi que des croisettes de cuivre originaires de la région cuprifère à quelques centaines de kilomètres au sud. Au cours des siècles, ces croisettes ont pris une forme de plus en plus standardisée et réduite, ce qui donne à penser qu’elles tenaient de plus en plus lieu de monnaie polyvalente. Mais le point qui nous intéresse le plus, c’est l’existence d’une certaine concentration du pouvoir dès une époque fort reculée (VIIIème siècle). Certaines tombes d’enfants contiennent un matériel funéraire somptueux, ce qui se conçoit difficilement dans le cadre d’une société acéphale.
En outre, certains des regalia qui sont actuellement employés par les chefs et les dignitaires se retrouvent dans ces mêmes tombes : c’est le cas de marteaux-enclumes, de haches de parade et de cloches ; qui plus est, les tombes qui contiennent ces objets sont généralement celles où l’on trouve les plus nombreux vestiges de poteries. La concentration du pouvoir n’est donc pas un phénomène récent dans la région. L’histoire est d’ailleurs à même de prendre le relais de l’archéologie à ce propos, pour des époques plus récentes. Les Luba sont en effet férus de traditions orales » (Petit, 1993 :60-61).
Cette citation du professeur Pierre Petit nous renseigne donc qu’on peut retrouver l’origine de l’État kiluba en étudiant l’archéologie. La région où habitent les Baluba montre une continuité humaine depuis l’an 500 de notre ère comme l’a pu démontrer le professeur Pierre de Maret (Maret, 2018 : 333-340). Les données archéologiques suggèrent que le noyau de l’État kiluba a émergé dans la dépression de l’Upemba (Nooter, 1996 : 20 et 28). Cet État s’est développé au sein d’un peuple possédant une homogénéité culturelle, religieuse et linguistique (Reefe, 1981 : 5). Reefe indique toutefois qu’il est difficile de définir précisément les circonstances de la genèse de cet État. Néanmoins, il est reconnu que l’État kiluba est apparu sur un territoire ayant depuis longtemps une culture matérielle particulièrement développée. À ce sujet, De Heusch écrit que :
« La civilisation luba, où la métallurgie et la statuaire en bois connurent un développement remarquable, surgit dans un milieu qui avait déjà connu une culture fort élaborée » (Heusch, 1972 : 18).
Selon ces auteurs, il semble difficile de postuler une continuité de peuplement entre la culture élaborée antérieure et les Baluba actuels, fondateurs de l’État kiluba. Il est également établi que le travail du fer et la métallurgie dans cette région remontent à l’âge du fer (Maret, 2018 : 333–340). Pierre de Maret situe la présence humaine dans cette région dès le VIe siècle après Jésus-Christ, ce qui indique que la sédentarisation dans cette zone remonte à une période ancienne de l’histoire. Bien que la période précise de l’émergence de l’organisation socio-politique ne puisse être déterminée avec exactitude, il est établi que la région où ce royaume est apparu se caractérisait par des échanges commerciaux intensifs, incluant le fer, le cuivre, les perles, le sel traditionnel et les colliers. Ces transactions remontent au moins au Ve siècle (Maret, 1985 ; Nooter, 1996 ; Petit, 2000). Selon ces auteurs, ces activités commerciales ont joué un rôle crucial dans l’expansion de l’État Kiluba, notamment du XVIIIe au milieu du XIXe siècle.
Cette version utilise un langage formel et académique pour clarifier les relations entre les cultures, les périodes historiques, et les activités commerciales.
L’absence de documents écrits n’a pas entravé la formulation d’hypothèses concernant certaines phases de la formation de l’État kiluba. En se fondant sur la collecte de données orales provenant du royaume de Kalundwe, où le roi Ilunga Stanislas Kanonge a affirmé en 2008 être le 43e Mulopwe après Nkongolo Mwana (la confrontation avec la liste fournie par Edmond Verhulpen semble corroborer ces déclarations), et en tenant compte de l’existence de cinq Balopwe par siècle, chacun ayant régné au minimum vingt ans, Lukanda Lwa Malale estime que l’État Kiluba aurait vraisemblablement vu le jour aux alentours du XIIe siècle, vers 1150 (Lukanda, 2018 : 496-497). Par ailleurs, en s’appuyant sur les activités commerciales, Isidore Ndaywel è Nziem avance quant à lui la date de 1300 (Ndaywel, 2011 : 45). Cette hypothèse et les arguments qui la soutiennent se rapprochent de la thèse de Crine-Mavar, qui situe la fondation du royaume vers 1450 (Crine-Mavar, 1974 : 76). Selon Crine-Mavar, les chefferies ayant constitué l’État Kiluba partageaient une unité linguistique, culturelle, religieuse, ainsi qu’une homogénéité dans les structures familiales et les institutions politiques.
Jan Vansina a consacré une réflexion approfondie à l’analyse des traditions orales en Afrique centrale. Il a postulé que l’État Kiluba est apparu aux alentours de 1500, lorsque Kongolo, un migrant, est arrivé dans la région des Kalanga pour s’y établir (Vansina, 1965 : 55). À l’opposé, Edmond Verhulpen estime que l’émergence du premier royaume se serait produite vers 1555, suivie par celle du deuxième royaume autour de 1585 (Verhulpen, 1936 : 135–138). D’autres chercheurs, plus exactement les mythistes de l’histoire kiluba tels que Thomas Q. Reefe, Pierre De Maret et Mary Nooter Robert, placent la genèse de cet État vers l’an 1700. De Heusch, bien qu’il ne se prononce pas avec précision sur l’année ou le siècle de la fondation de cet État, lui attribue une origine mythique en contestant l’existence historique de figures comme Nkumwimba Nkongolo Mwamba, Ilunga Mbidi Kiluwe et son fils Kalala Ilunga.
Cette approche remet en question la validité de la conscience historique des populations autochtones. Il convient de souligner que, selon les traditions et la mémoire historique des Baluba, Nkongolo Mwamba est perçu non pas comme un personnage étranger, mais comme un Múlúba appartenant à la tribu des Baluba-Bakalanga (Womersley, 1984 : 1-5). Il n’existe pas une seule légende kiluba qui le présente comme un mythe. C’est une personne réelle et dont les preuves onomastiques prouvent de son existence humaine.
La diversité d’interprétations illustre la difficulté d’établir une période chronologique uniforme qui fasse consensus au sein de la communauté scientifique. Il apparaît que certaines données n’ont pas été prises en considération ou que l’interprétation de certains événements a été effectuée hors de leur contexte originel. De plus, certains auteurs, tels que Reefe, refusent de reconnaître l’existence de certains souverains.
En effet, Reefe, pour ne citer que lui, rejette plus de six empereurs figurant sur la liste officielle, arguant que les récits historiques relatifs à ces derniers manquaient de fiabilité ou constituaient, selon lui, des “ajouts” de la part des informateurs visant à étendre artificiellement la durée et l’envergure de la dynastie luba (Reefe, 1981 : 45–55). Par conséquent, il n’a retenu que six souverains, ce qui explique pourquoi ses estimations ne remontent qu’au XVIIe siècle. De son côté, Mary Nooter Robert rapporte que les Baluba auraient bénéficié de plus de 1500 ans d’histoire sociopolitique ininterrompue (Nooter, 1996 : 28). Cela suggère une séquence archéologique d’un millénaire d’histoire continue, sans aucune interruption.
Harold Womersley soutient que les Baluba n’ont subi aucune domination étrangère au cours du millénaire connu de leur histoire (Womersley, 1984 : 60). Isidore Ndaywel è Nziem, quant à lui, affirme que les relations sociopolitiques entre les Baluba et les Balunda, qui ont conduit à la formation d’une identité culturelle et politique commune, remontent à plus d’un millénaire (Ndaywel, 1998 : 145). En définitive, l’émergence de l’État Kiluba semble être antérieure à la majorité des hypothèses précédemment formulées. Il est donc raisonnable de considérer que l’hypothèse situant l’apparition de cet État au VIIIe siècle est la plus plausible.
Discussion
L’organisation sociopolitique kiluba (des Baluba) a fait l’objet de multiples études au sein de la recherche scientifique, témoignant de l’intérêt qu’elle suscite. Cet intérêt s’explique par le fait que le système politique des Baluba s’articule autour d’une organisation sociale singulière, offrant ainsi une clé de lecture précieuse pour l’histoire politique de nombreuses sociétés africaines (Maxwell, 2016 : 367-392). Toutefois, un écart notable apparaît entre le continuum chrono-historique révélé par les traditions orales et les thèses soutenues par les chercheurs à propos de l’État kiluba. Cet écart se manifeste principalement dans l’interprétation psychologique des autochtones et dans la méthodologie employée pour l’étude de l’historiographie kiluba par les chercheurs non-Baluba. Il convient de rappeler que l’Afrique a longtemps été perçue comme un continent dénué de toute organisation sociopolitique sophistiquée, autrement dit, comme un territoire à « civiliser » (Plasman, 2015 : 583-586). Ainsi, pour certains auteurs, l’Afrique ancienne n’était rien de plus qu’une vaste étendue forestière habitée par des « nomades se déplaçant du Nord au Sud ». Selon Pierre Mercier (1962), cette perception a vu le jour au début du XVIIIe siècle, à une époque où les puissances occidentales cherchaient à légitimer leur domination sur les populations africaines.
Des auteurs d’une notabilité incontestable, tels que Montesquieu, Victor Hugo ou encore Hegel, ont véhiculé l’idée selon laquelle les Africains et l’Afrique traditionnelle étaient dépourvus d’histoire, nécessitant ainsi une civilisation qui les « rendrait à l’humanité », pour reprendre les mots de Victor Hugo. Cette conception explique en partie le discours belge qui prétendait que le roi de Belgique avait fait preuve d’humanisme en entreprenant de « civiliser » l’Afrique centrale. À ce propos, Pierre-Luc Plasman, évoquant la création de l’Association Internationale du Congo (AIC), précurseur de l’État Indépendant du Congo, avance :
« Autour de la conférence de Berlin, Léopold II entreprend des démarches bilatérales pour faire reconnaître l’AIC comme une puissance politique. Intelligemment, le Roi négocie avec des États-Unis, qui ne sont pas impliqués dans les rivalités européennes, mais dont la problématique africaine les intéresse au travers de la lutte antiesclavagiste. Les termes de l’accord bilatéral sont absolument fondamentaux puisque d’une part la mission civilisatrice est définie comme étant la finalité de l’AIC » (Idem, 2015 : 586).
Selon l’analyse de Pierre-Luc Plasman, Léopold II se serait engagé dans une entreprise de « civilisation » des populations du bassin du Congo, considérées à l’époque comme non-civilisées. Cette conception de l’Afrique traditionnelle n’a pas été complètement reléguée au passé et demeure encore profondément ancrée chez de nombreux chercheurs. La vision négative de l’Afrique traditionnelle, perçue comme un continent dénué d’organisation politique rationnelle, continue de dominer l’imaginaire académique, y compris parmi les africanistes européens. Il est impératif d’adopter une perspective différente. Il est crucial d’affirmer ce que beaucoup de chercheurs hésitent encore à reconnaître comme une vérité historique. En effet, cette perception dépréciative de l’Afrique traditionnelle a été largement réfutée par des recherches rigoureuses et impartiales. Mercier écrit dans l’introduction de son essai sur le royaume de Bénin :
« Les premiers voyageurs (Européens) parlent de peuples et de Nations, là où les derniers voyageurs, avant la conquête coloniale, parleront de Tribus et des Peuplades. Les premiers parlent avec sérieux et même avec respect des Rois et de leur puissance. Avec le 18ème siècle, l’irrespect commence à apparaître » (Maes, 1993 : 164 – 199).
Constatons néanmoins que de nombreux préjugés et perceptions négatives concernant l’histoire ancienne de l’Afrique ont largement influencé, sinon dicté, la rédaction de l’histoire générale de ce continent. Bien que les vocabulaires, adjectifs et qualificatifs aient été remplacés par des termes « acceptables », le fond du problème demeure inchangé. Ainsi, le mal est d’une profondeur et d’une subtilité extrêmes.
La majorité des chercheurs continue en effet de manifester un intérêt marginal et peu approfondi pour l’histoire de l’organisation politique en Afrique. Il est crucial de remettre en question certains paradigmes de la pensée scientifique, notamment le modèle cartésien et les approches complexes des sciences, afin de restituer de manière authentique la conscience historique des sociétés africaines. La vérité demeure néanmoins indéniable : l’Afrique possédait des États ayant connu une évolution significative. Il est même tentant de les qualifier d’« États-nations », tant il est clair que la notion d’État-nation n’est pas exclusivement occidentale. Manuel Corachan Cuyas, dans son essai Historia del África Negra precolonial: la historia que Occidente ignoró, démontre que des organisations politiques existaient en Afrique dès le Ve siècle, et que le VIIe siècle marque le début de l’émergence de grands royaumes en Afrique de l’Ouest (Corachan, 2013 : 65). Cela signifie que l’organisation politique en Afrique n’était pas restée figée jusqu’à l’arrivée des violences telles que les razzias humaines, le commerce triangulaire et la colonisation.
Les recherches ethnographiques, archéologiques ainsi que les écrits arabes ont révélé l’existence d’États africains indépendants, souverains et dotés de structures démocratiques. Il est vrai que les Africains de l’époque n’avaient pas un terme spécifique pour désigner la démocratie (Maligui, 2009 : 18). Cependant, tout comme en Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale a également connu une évolution politique notable, que certains chercheurs situent au XIIe siècle. Les deux grands États d’Afrique centrale étaient le royaume Kongo et le royaume des Baluba. C’est à partir de ces deux États que s’est propagée l’organisation politique de nombreux peuples en Afrique centrale (royaume Kongo) et en Afrique australe (État Kiluba). Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrerons uniquement sur le Bulopwe des Baluba.



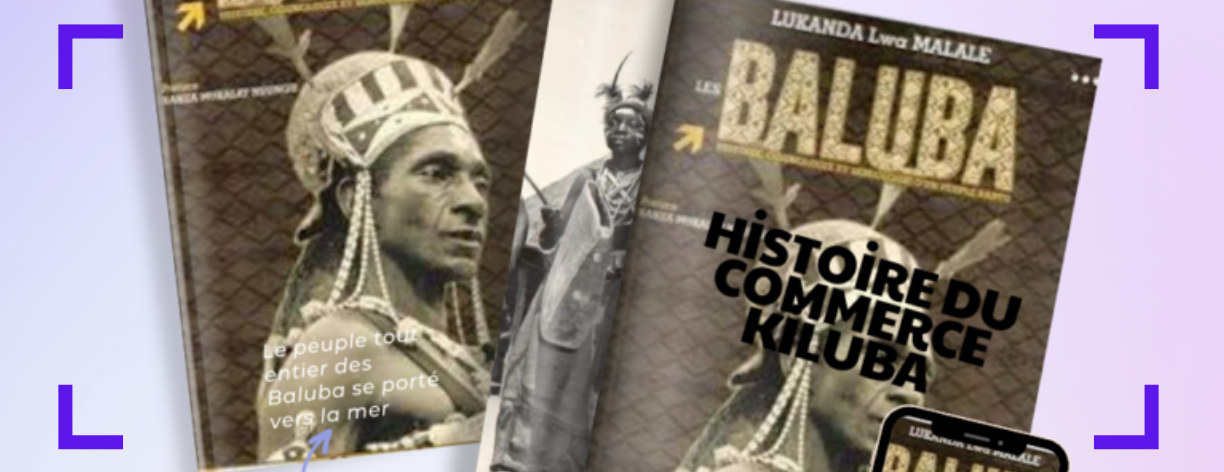
One Reply to “Organisation politique des Baluba”
Patient, mai 31, 2025
Merci pour cette excellent travail.